American clichés
Le bonheur à tout prix...
Extrait :
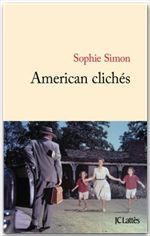 ED BOOKMAN
ED BOOKMAN
Ed Bookman travaillait dans une des plus grosses banques d’affaires de New York. À son étage, il était réputé pour son extrême gentillesse et ses écharpes tricotées par son épouse Eleonore. Ed semblait pleinement satisfait de son travail. Il avait débuté en distribuant le courrier dans les étages de la compagnie, et avait gravi les échelons un à un pour accéder au poste de comptable de la section 7a. Depuis qu’Ed avait été nommé à ce poste, plus jamais il n’avait cherché à monter en grade. Il s’estimait déjà bien chanceux de posséder son propre bureau.
Celui-ci était constitué de trois cloisons en verre ; une sorte d’aquarium juxtaposé à d’autres aquariums parfaitement ordonnés dans une immense salle éclairée de néons, au vingt-deuxième étage d’une tour qui en comptait quarante.
Chaque jour, Ed quittait le bureau à dix-sept heures trente, sa vieille sacoche en cuir à la main, et gagnait en métro la Gare centrale. Il retrouvait ensuite son train pour un trajet de vingt minutes jusqu’à sa petite banlieue du New Jersey, où Eleonore et leurs deux délicieuses fillettes l’attendaient dans leur modeste mais coquet pavillon.
Ce soir-là, le train resta bloqué plus d’un quart d’heure entre deux gares, jusqu’à ce qu’on répare la panne. C’était déjà arrivé quelques fois, et le train finissait toujours par repartir, mais Ed détestait cela parce qu’il savait qu’Eleonore s’inquiétait au moindre de ses retards. Et puis, ils étaient invités à dîner chez son frère.
Ed essayait de garder son calme, comme le faisaient la plupart des voyageurs, habitués à ce genre d’incident. Mais l’image d’Eleonore l’obsédait. Elle était capable d’appeler les hôpitaux et les postes de police. « Personne n’est donc fichu de réparer ce train ? » se répétait-il.
Il se leva, jeta un œil par la fenêtre du wagon et héla un mécanicien qui passait près des rails. Mais le type s’éloigna sans lui prêter attention.
Ed resta debout au milieu du compartiment, sa sacoche à la main, à guetter dans le regard d’autres passagers un éventuel soutien. Mais chacun semblait ignorer la panne autant que ses appels silencieux.
Enfin, la lumière se rétablit dans la rame et le train s’ébranla. Ed retourna s’asseoir, sortit un mouchoir de sa veste et essuya la sueur de son front. Il sourit en hochant la tête sous l’œil indifférent des voisins.
– Seigneur, Ed, te voilà enfin !
– Je suis désolé Elie, il y a eu une panne…
– Nous sommes très, très en retard !
– Je sais chérie, je file me doucher.
– Non, d’abord il faut que tu ailles en ville chercher des fleurs pour Maggie, je n’ai pas eu le temps et j’attends la petite Hattaway qui vient garder les filles.
– Elie, je viens d’arriver, pourquoi ne coupes-tu pas quelques fleurs du jardin ? demanda Ed en posant sa sacoche sur le petit fauteuil crapaud de l’entrée.
– Ed !
– OK ! J’y vais ! Embrasse les filles pour moi.
Ed monta dans sa Ford et emprunta la petite route qui longeait le canal pour aller en ville. Il y avait rarement du monde sur cette petite route. De rares promeneurs, comme ce jour-là, cet homme et son épagneul. Les automobilistes préféraient prendre l’autre voie, de l’autre côté du canal, plus directe et rapide. Ed, lui, adorait ce chemin bordé de massifs fleuris qu’entretenait la ville avec soin. Cette route le mettait toujours de bonne humeur. Elle avait quelque chose de bucolique et d’irréel, comme un décor de film pour enfants. C’était un paradis où rien de mal ne pouvait survenir.
Ed arriva chez le fleuriste en dix minutes et en mit plus de quinze à composer son bouquet. Il était superbe et Ed en était très fier. En réalité, il avait plus pensé à sa femme en l’achetant qu’à Maggie.
Sur le chemin du retour, il essayait de se remémorer le nom de chaque fleur, ça aurait tant impressionné Eleonore, mais à part les pivoines, qu’elle adorait, il ne se souvenait de rien.
Il se dit qu’il aurait pu en prendre un aussi pour elle. Il réfléchit quelques instants puis freina, après avoir jeté un rapide coup d’œil dans le rétroviseur pour s’assurer que personne n’arrivait derrière lui. Mais au moment où il entreprit son demi-tour, il ne vit pas le motard qui fonçait droit sur lui. Et quand il entendit le klaxon, il était déjà trop tard. Ed paniqua, le motard klaxonna encore et encore en lui faisant signe de dégager.
Il ne percuta pas la voiture d’Ed mais freina si brutalement qu’il perdit le contrôle de son engin, et, fracassant le parapet, il disparut dans l’eau sombre du canal.
Le promeneur était à quelques mètres de là. Il retenait son jeune épagneul qui tirait sur la laisse comme un forcené. L’homme recula lentement, et sans lâcher la scène des yeux, s’enfonça dans l’épais feuillage d’un talus.
À l’endroit où la moto et son passager venaient de s’abîmer, Ed ne vit rien d’autre que des bulles remonter à la surface qu’une trace d’huile irisait. Il savait nager, mais ne plongea pas. Des bulles d’air remontèrent encore pendant quelques minutes, puis se raréfièrent et disparurent totalement. Ed enfouit son visage entre ses mains et éclata en sanglots. Après de longues minutes, il inspira, renifla, et cessa de pleurer.
Le promeneur bloquait la mâchoire de son chien entre ses genoux. L’animal remuait la queue et se débattait pour se libérer la tête.
– Chut ! Penny ! Calme-toi.
L’animal obéit et s’assit sur son postérieur.
Ed jeta un œil aux alentours puis regagna sa voiture.
L’homme et son chien sortirent de leur cache.
La nuit commençait à tomber.
– C’est toi ? cria Eleonore du premier étage.
– Et qui veux-tu que ce soit ? soupira Ed, comme pour lui-même.
– Tu as vu l’heure ?
– Je sais. J’ai mis du temps à choisir les fleurs.
Il se doucha longuement. Trop longuement d’après Eleonore.
– Ed ! J’ai l’impression que tu n’as pas envie d’aller chez ton frère ! cria-t-elle de la chambre. Dépêche-toi, veux-tu ?
– Je suis un peu fatigué, je me demande si je n’ai pas attrapé quelque chose, répondit-il de sa douche. Mais ça va aller.
Ed se prépara avec les vêtements qu’Eleonore avait posés sur le lit et la rejoignit dans l’entrée.
– Tu es très beau, mon chéri ! lui dit-elle en arrangeant le nœud de sa cravate.
Ed Bookman n’était pas si beau que ça. Sous certains angles, il était même assez laid. Mais sa grande taille et sa minceur lui conféraient une certaine allure et parfois, lorsqu’il daignait faire un peu attention à sa façon de s’habiller et de se tenir, un vague air de James Stewart.
Ed n’était pas du genre négligé, mais si son épouse ne prenait soin de lui préparer sa tenue, il était capable d’enfiler une chemise jaune pâle et un gilet vert.
Eleonore s’installa dans la voiture, son sac à main sur les genoux, et jeta un œil par-dessus son épaule, sur le bouquet posé à l’arrière. Ed démarra.
– Tu n’as pas pensé à en acheter un pour moi ? hasarda-t-elle.
Ed ne réagit pas, et conduisait en regardant fixement la route éclairée de ses phares.
– Tu m’écoutes ? demanda Eleonore.
Ed freina et rangea la voiture sur le bas-côté.
– Ed ! Qu’est-ce que tu fabriques ?
Il posa la tête sur le volant et se mit à pleurer. Eleonore le secouait en criant, et essayait de le redresser. Mais Ed retombait sans cesse comme un poids mort, le front heurtant le volant chaque fois. Enfin il se mit à parler, à raconter l’accident. Eleonore se tut. Elle l’écoutait sans l’interrompre, les mains cramponnées à l’anse de son sac, le regard absent, fixé sur les lèvres de son mari. Ils restèrent ensuite un long moment sans rien se dire, sur la jolie petite route enténébrée.
– Qu’est ce qu’on fait ? demanda Ed, rompant le silence.
Eleonore sortit de son sac son poudrier et un mouchoir, puis déplia le petit miroir du pare-soleil, et se repoudra le visage.
– Allons-y, dit-elle.
– Où ça ?
– Eh bien chez ton frère ! À moins que tu préfères aller te livrer à la police.
Ed baissa les yeux.
– Qu’attends-tu pour démarrer ? Bon sang on est déjà tellement en retard.
Ils n’échangèrent plus un mot du trajet.
Le temps d’appuyer sur la sonnette de la porte d’entrée, Eleonore se composa un air aimable et détendu. Et lorsque Maggie ouvrit avec un cri strident de bienvenue, son visage se crispa en une caricature de sourire. Quant à Ed, malgré sa pâleur, il s’efforça à l’affabilité.
Maggie ne remarqua rien (en dehors de leur retard, ce qui n’était pas bien, leur dit-elle, en agitant son index comme une maîtresse d’école). En revanche, quand Eleonore entra dans le salon, elle perçut dans la voix de George, son beau-frère et l’époux de Maggie, comme un voile de lassitude. Il y avait d’autres invités à ce dîner : les Grewman et les Huster. Des voisins. Les femmes semblaient sortir du même salon de coiffure ; même blond, même mise en plis. L’atmosphère était quelque peu pesante, les sourires forcés et les mots chuchotés.
Maggie, imperturbable hôtesse, frappa dans ses mains et invita l’assemblée à passer à table.
Au moment même où les invités s’apprêtaient à s’asseoir, Angie, adolescente brune et véhémente, dévala les escaliers.
Elle portait une petite veste en coton rouge, un chemisier et un jean retroussé sur des tennis blanches, et tenait contre son ventre un gros sac de voyage. Ses cheveux étaient peignés et attachés en une épaisse queue-de-cheval et une frange courte barrait son front. Mais ses pommettes et ses yeux étaient rouges, comme si elle venait de pleurer, et elle avait dissimulé sa peine et sa rage sous une copieuse couche de maquillage.
La jeune fille respirait en soulevant haut sa poitrine, comme pour s’armer de courage. Elle se tourna vers sa mère, et hoqueta :
– Je m’en vais et tu n’auras plus jamais de mes nouvelles. Je te hais comme tu ne peux pas imaginer et je me demande comment fait papa pour te supporter.
– Angie ! intervint George.
Les invités se tenaient debout, les mains posées sur le dossier de leur chaise, le regard fuyant. Maggie tenta de dédramatiser la scène en levant les yeux et en prenant ses hôtes à témoin.
– Je te hais, toi et ton air hypocrite ! poursuivit Angie. Je te préviens que si Barry a fait une bêtise, j’en ferai autant.
– Je vous prie de m’excuser une seconde ! souffla Maggie en inclinant son buste volumineux.
Elle se leva.
– Viens avec moi, chérie, dit-elle, mielleuse, en avançant le bras pour saisir celui de sa fille.
Mais celle-ci se recula et frappa sa mère au visage. Tout le monde poussa un cri. Même Eleonore et Ed. Maggie cacha son visage entre ses mains et courut s’enfermer dans sa chambre.
Une fois débarrassé de Maggie, George se précipita vers Angie, la prit dans ses bras et tenta de la consoler.
C’est lui qui un peu plut tôt dans la soirée, alors que Maggie finissait de préparer le dîner pour ses invités, avait ouvert la porte à Barry, le petit ami d’Angie. C’est lui qui l’avait pris à part avant que Maggie ne le voie :
– Barry, tu sais très bien que tu n’es pas le bienvenu ici. Je n’ai rien contre toi… Tu sais bien… C’est…
– Je sais, monsieur Bookman, c’est votre femme, mais il faudrait qu’elle comprenne que j’aime Angie et que si elle nous empêche de nous voir on va partir tous les deux. Faut que vous le sachiez ça aussi, monsieur Bookman.
– Ça, mon garçon, il n’en est pas question ! Vous n’irez nulle part, toi et Angie. Elle n’a même pas seize ans, elle reste chez ses parents.
George avait dit ça calmement, mais Barry avait pu voir les maxillaires de George se crisper.
– Vous avez déjà été amoureux, monsieur George ? Vous avez épousé Mme Bookman, donc vous devez savoir ce que c’est ?
George avait enfoncé les mains dans ses poches de pantalon. Il avait paru chercher loin dans sa mémoire, mais aucune émotion n’avait troublé son regard.
– Mais peut-être ignorez-vous ce que c’est de ne pas voir la personne qu’on aime le plus au monde. Je vous jure, monsieur George, parfois elle me manque tellement que j’ai envie de foncer droit dans le canal avec ma moto.
George releva la tête.
